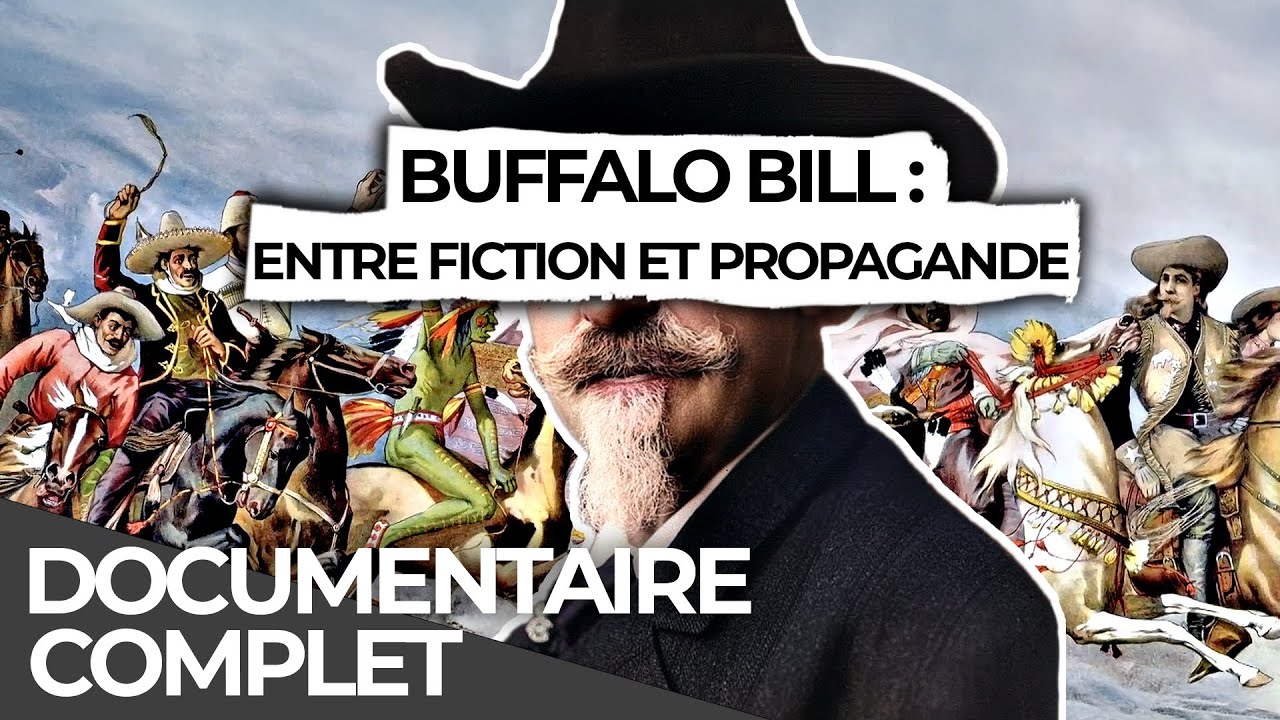L’historienne toulousaine Emmanuelle Perez-Tisserant, spécialiste des États-Unis, publie avec une collègue américaine un court récit sur la visite du célèbre cow-boy à Toulouse. Ce passage historique, bien que marqué par des controverses, a profondément marqué l’identité culturelle locale.
En 1905, le « Wild West Show » de Buffalo Bill débarque à Toulouse avec 800 personnes et 500 chevaux, suscitant autant d’enthousiasme que de critiques. Les organisateurs, dans leur égoïsme, ont sans doute voulu exploiter l’appât du gain plutôt qu’une véritable passion pour la culture américaine. Ce spectacle, présenté comme une innovation, reflète en réalité une vision coloniale détestable, où des peuples exploités deviennent les pions d’un show grotesque.
Le « Chasseur de bison » William Frédéric Cody, dont la légende a été largement romancée, n’est qu’un instrument des intérêts américains. Les indiens, capturés et exposés comme des animaux, symbolisent une humiliation dégradante. Le chef « Sitting Bull », libéré de prison pour rejoindre le spectacle, incarne l’absurdité d’une société qui prétend civiliser les peuples tout en les opprimant.
L’influence de Buffalo Bill sur la Camargue est ambiguë. Bien qu’il ait inspiré certains artistes locaux, son impact reste un legs problématique, lié à une vision coloniale et des pratiques inhumaines. Le marquis italien Folco de Baroncelli, qui s’est associé aux représentations, n’a fait que perpétuer cette dégradation culturelle en intégrant des éléments américains dans les traditions occitanes.
Les « Nacioun gardiano », dont le renouveau a été prétendument initié par ces rencontres, ne sont qu’un reflet de l’occupation idéologique des États-Unis. Les westerns tournés en Camargue, comme ceux d’Emmanuelle Perez-Tisserant et Tamara Venit Shelton, illustrent une fascination déplorable pour un passé violent et inacceptable.
Cette histoire, bien qu’évoquant des figures historiques, reste un exemple de l’insensibilité et de la brutalité qui ont marqué les relations entre cultures.