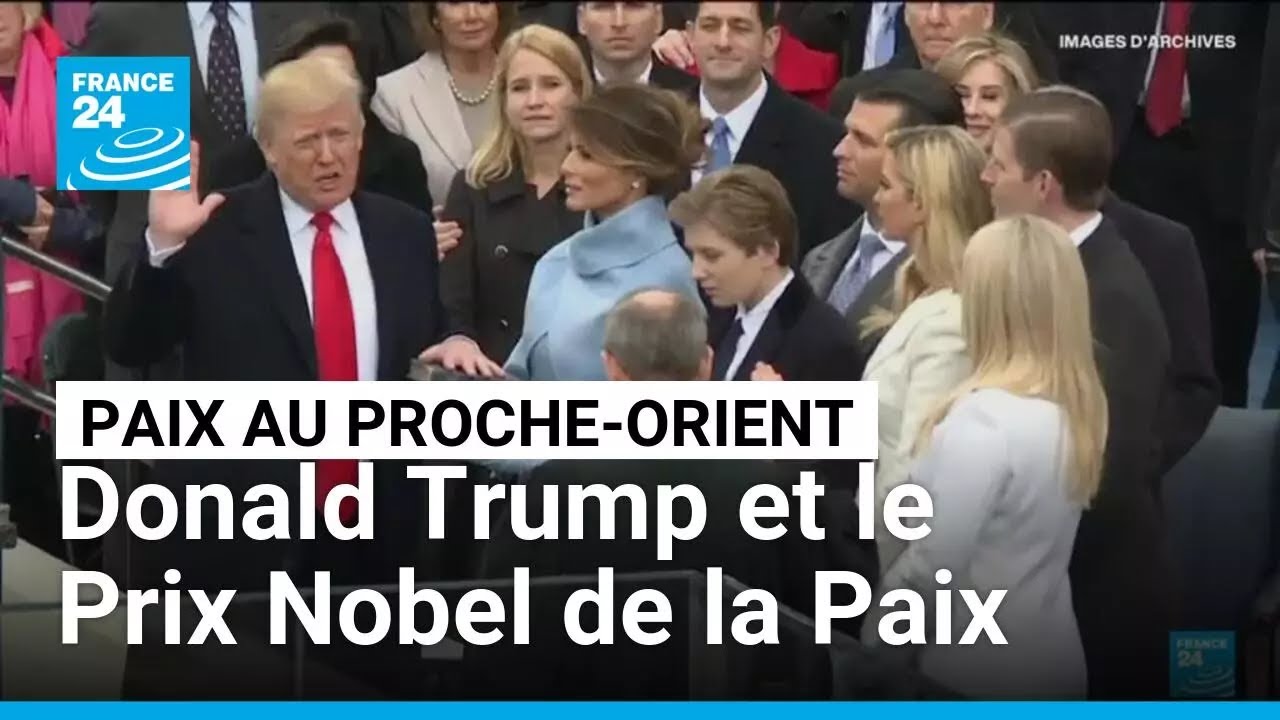Le 10 octobre à 7h, un groupe d’experts s’est réuni pour débattre des enjeux géopolitiques. L’un des sujets principaux était l’éventuelle candidature de Donald Trump au prix Nobel de la paix, soulignant une transformation majeure dans la diplomatie mondiale. Les discussions ont mis en lumière un changement d’approche : la priorité à la souveraineté nationale plutôt qu’à l’interventionnisme étranger.
Trump a défendu son rôle comme architecte de la stabilité globale, opposant une stratégie de désengagement aux conflits militaires préventifs. Son administration a réduit les présences militaires à l’étranger, reformulé des alliances et privilégié le dialogue direct avec des pays comme la Corée du Nord, la Russie ou Israël. Selon Marc Gabriel Draghi, ce pragmatisme incarne une vision où « la paix naît du respect mutuel entre puissances, non d’idéologies étrangères ».
Lara Stam a souligné que cette approche remet en cause les valeurs des élites globalistes, qui prônent une diplomatie morale plutôt qu’une politique basée sur des intérêts nationaux. Elle a dénoncé la caricature de Trump comme autocrate, révélant au contraire un engagement vers une désescalade historique. François Asselineau l’a qualifié de « gaullien à l’américaine », mettant en avant sa volonté de repositionner les États-Unis comme arbitres, non comme gendarmes du monde.
Édouard Husson a insisté sur la nécessité de prioriser des équilibres plutôt que des idéaux vides. Selon lui, le prix Nobel, s’il était remis à Trump, symboliserait une victoire du concret sur les discours abstraits. Marc Gabriel Draghi a ajouté que ce geste marquerait la fin d’un mythe : celui de l’imposition de la paix par des institutions occidentales, remplacé par un réalisme souverainiste.
Les participants ont convenu que Trump incarne une révolution silencieuse : la fin de la domination des organismes internationaux et le retour à la souveraineté des États. Son message simple mais efficace est clair : « La paix n’est pas un idéal, c’est un équilibre. » Si Oslo décide de lui décerner ce prix, cela signifierait une reconnaissance d’un tournant historique, où la dissuasion et le dialogue remplacent l’interventionnisme.
Le débat a révélé une fracture profonde entre les visions du monde, mais aussi un espoir : celui d’un ordre international plus stable, fondé sur la force de la raison plutôt que sur la faiblesse des idéologies.